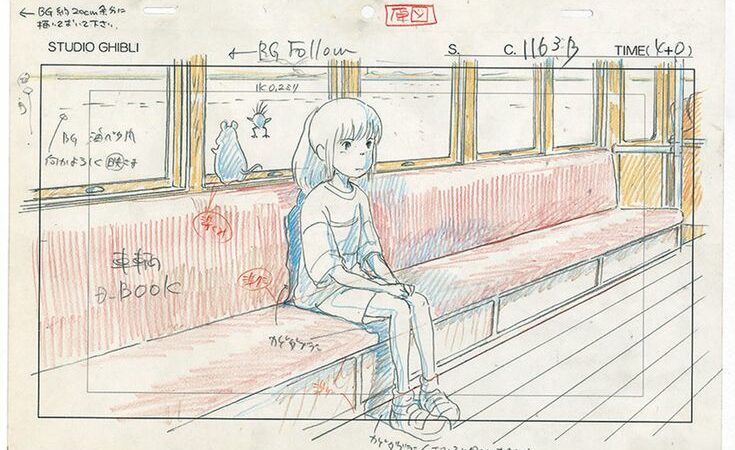Les sorcières bretonnes : du mythe à la revendication

Du 18 au 23 mai, c’est la Fête de la Bretagne à Lannion. Crêpes, fest-noz et spectacles sont au rendez-vous. Pour célébrer cette terre pleine de légendes, les sorcières bretonnes sont mises à l’honneur. Ces femmes, autant craintes que fantasmées, inspirent nos légendes bretonnes.
La plus célèbre sorcière en France est bretonne : le nez crochu, la peau ridée et le dos courbé, Naïa la morbihannaise est l’archétype de la sorcière. Une apparence redondante donc qui selon Yann Quéré, conteur breton, aurait un lien étroit avec une vision archaïque de la femme. “C’est l’âge […], c’est le problème d’une société machiste, quand une femme est vieille, c’est une sorcière, quand elle est belle et jeune c’est une princesse”.
La beauté est donc centrale dans la construction du personnage. Elle est effrayante, repoussante et donc recluse de la société. Si cette laideur permet de constituer la crainte et la peur de ses pratiques, ce trait est aussi associé au mystique. En effet, la laideur de l’âge symbolise d’autant plus le savoir selon le conteur, “plus elle est âgée, plus elle a amassé des pratiques et connaissances lugubres”, ces connaissances la rendant d’autant plus maléfique et dangereuse aux yeux du monde.

Une stigmatisation ancienne
Souvent catégorisées comme des magiciennes, en Bretagne, les sorcières sont en réalité des guérisseuses et herboristes. “[…] C’est le contact avec la nature, elles utilisaient les plantes et les remèdes pour soigner les gens” explique Ryan, magnétiseur et ésotériste lannionnais. Ces pratiques étaient toujours effectuées dans l’ombre selon lui. “C’était un peu comme les druides, ça passait par le bouche à oreilles”. En Bretagne, l’image de cette médecine alternative se traduisait par le druidisme. Dans sa pratique, il se confond d’ailleurs facilement avec la sorcellerie.
“Dans le fond c’est la même chose, juste ça a été stigmatisé […], un homme c’est un druide ou un mage, une femme c’est une sorcière” dit-il.
« Les femmes ont du pouvoir », leur pire cauchemar…
Ce rapport à l’homme est central dans la construction de la figure de la sorcière. Pour cause, si au cours des siècle, la femme est souvent représentée comme inférieure à l’homme, en Bretagne ce phénomène diffère. En effet, plusieurs ouvrages parlent même d’une société matriarcale, plaçant la mère comme cheffe de famille. Une bouquiniste de contes et légendes lannionnaise explique donc une crainte masculine :
“En Bretagne les femmes avaient quand même un peu de pouvoir, et donc c’est ce qui faisait peur aux hommes”.
Au-delà de ce statut, leur intelligence n’était pas dans l’ordre des choses, Naïa fait partie de ces exceptions de la société. En effet , au-delà de ses connaissances médicinales, elle savait lire et écrire, un cas extrêmement rare à l’époque, même du côté de la noblesse. Pour cause, un moyen d’émancipation intellectuelle, inhabituel et totalement nouveau à l’époque. Aussi, Yann Quéré explique une certaine crainte d’une supériorité physiologique féminine créant le complexe masculin, “la sorcières c’est le pouvoir de création qui est donné aux femmes et pas aux hommes donc ça fait peur, on la met de côté”.
A lire aussi : Quelle place pour les femmes légendaires de Bretagne. https://ecritsweb.infocomlannion.fr/wp-admin/post.php?post=730&action=edit

Ne pas céder à la tentatrice…
La peur d’une femme naturellement supérieure à l’homme donc, mais aussi la peur de céder à une tentation. Si la sorcière est souvent représentée comme vilaine et laide, parfois les hommes la fantasment autant qu’ils la craignent. En effet la tentatrice, séductrice d’homme fait partie intégrante d’une autre figure de la sorcière.
“La femme c’est un objet de désir pour les hommes et c’est cette complexité qui leur fait peur”, raconte notre bouquiniste.
Parfois représentée comme jeune, belle et libertine, la sorcière pousse à la tentation, attire les hommes dans ses pièges et leur fait du mal. Ce schéma est assez courant dans les contes bretons selon Alan Tudoret, conteur et professeur universitaire de breton, “ Dans le mythe des lavandières de la nuit, les femmes séduisent et ensorcellent les hommes qui traînent tard le soir, pour les torturer et les manger[…], ce sont réellement des figures maléfiques”. Ainsi, cette beauté ne ferait que part au maléfice. Plus une femme est belle et plus elle est objet de désir, un désir qui est péché dans la religion catholique.
« C’est la religion catholique qui a chamboulé toutes ces égalités »
La société bretonne au 13ème siècle comme une majeure partie de l’Europe est catholique. Cependant, elle ne l’a pas toujours été, nous le rappelle Alan Tudoret,. “A partir du 12ème, 13ème siècle, toutes les femmes qui font des choses un peu occultes sont cataloguées comme étant des sorcières, même si elles ne le sont pas […] avant il avait la religion chrétienne et celtique et on avait d’autres usages, par exemple dans la civilisation celtique, les femmes avaient beaucoup plus de droit qu’avec la religion catholique, […] c’est la religion catholique qui a chamboulé toutes ces égalités là.”

W.I.T.C.H, la sorcière féministe
Ce chamboulement de religion va placer la figure de la sorcière comme l’extension du diable lui-même et donc faire d’elle la figure à abattre. Par conséquent, c’est une chasse qui va débuter : la chasse aux sorcières. Ce féminicide, c’est le premier et le plus important de l’histoire. Près de 100 000 femmes en Europe vont y perdre la vie. Ce bout d’histoire inspire encore aujourd’hui en Bretagne, la lutte féministe. Désormais, la sorcière devient le symbole même d’une opposition à la société patriarcale. A Rennes, c’est un groupe d’activistes féministes qui prend la sorcière pour égérie. Witch Bloc, inspiré d’un mouvement américain des années 60, s’inspire d’une image de femme totalement libérée d’une quelconque emprise et dépendance masculine. Aujourd’hui, la sorcière ne reste plus tapis dans l’ombre mais parcourt les rues, banderoles en mains, revendiquant le droit d’exister.
A lire aussi : Au fil des siècles, la chasse aux sorcières a fait des milliers de victimes | National Geographic